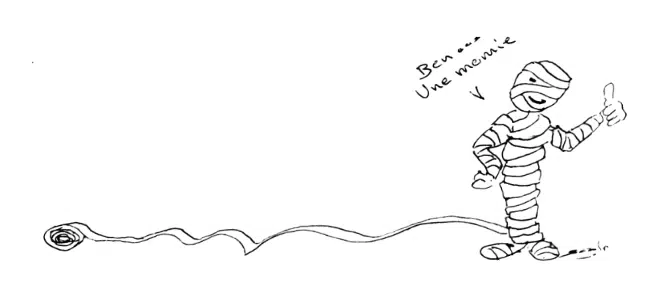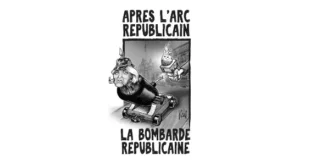Suite et fin de l’article paru dans le dernier numéro, page 17. Nous avions vu les choix à faire bien avant le décès, si c’est possible bien sûr, les actes à mener et à vivre dans les 24 heures, puis le début des obsèques. Voici des informations concernant plus en détail la cérémonie des funérailles, recueillies lors des Rencontres mortelles, édition automne 2023 sur le plateau de Millevaches, à l’initiative de l’association Par la Racine que nous remercions ici.
Six jours ouvrés pour organiser les obsèques
Les proches ont six jours après le décès, non comptés le week-end et les jours fériés, voire plus dans le cas de situation exceptionnelle comme le rapatriement d’un corps venant de l’étranger1. Rappel : il vaut mieux réfléchir aux grandes étapes et différents choix avant le décès ! Comme la mise en bière avec les pompes funèbres par exemple.
La cérémonie, souvent publique, c’est à dire le recueillement avec la famille, les amis, les voisins, avant le cimetière ou le crématorium, est une étape qui peut se dérouler où on veut ! Dans un bar, une salle des fêtes, chez soi, dans un bâtiment approprié pour les cérémonies religieuses, etc.
S’il n’y a pas de changement de commune, on peut aller au cimetière à pied, en suivant un corbillard décoré ou un tracteur si on a envie ! Le corbillard (de nos jours voiture noire banalisée) est obligatoire seulement si la commune d’inhumation est différente de celle du décès. Et sur les derniers 100 m, on peut demander à porter soi-même le cercueil.
Où va le corps ?
En France, on est inhumé ou incinéré. L’inhumation se fait dans un cimetière, on peut déposer le cercueil en pleine terre mais dans la majorité des cas, il y a un caveau, avec ou sans fond, avec ou sans monument dessus (souvent en granit qui vient de Bretagne ou du Tarn, sinon de l’étranger). Autrefois les protestants avaient des cimetières privés (les Corses aussi), mais c’est fini, la loi de 2008 l’interdit.
L’inhumation se fait à 1 m 50 de profondeur (protection contre les gaz) en respectant un vide sanitaire.
Aujourd’hui, en France, 40 % des gens font le choix de l’incinération2, la progression est rapide. Mais ça pollue un peu et la chaleur produite est en général gaspillée, de plus, au crématorium c’est l’usine avec six à dix crémations par jour…
Les cendres : on peut les répandre en mer à minimum 400 m du littoral ou à 5 km de la côte dans une urne. On peut aussi les déverser dans la forêt (pleine nature non aménagée obligatoire), dans un espace non partagé : pas chez soi dans son jardin ! On peut les transporter dans n’importe quel contenant, attention un adulte c’est six litres de cendres… Si on les laisse dans une urne, celle-ci peut être inhumée en cimetière : dans une concession privée, ou dans un espace dédié de dépôt ou d’inhumation des urnes. Sinon les cendres sont dispersées en pleine terre, dans le jardin du souvenir (puits de dispersion) ou sous de l’herbe selon les réglementations spécifiques des différentes communes et leurs cimetières.
Le droit d’être inhumé
Pour être enterré dans un certain cimetière, il faut habiter la commune au moment de la mort ou y être décédé.
Rapidement : sur un cimetière, la commune possède des terrains, mais il y a surtout des concessions. Car une loi, en 1804, a permis des exceptions, concédées à des personnes qui avaient la possibilité d’acheter et de posséder, pour une longue période, des terrains « privés ». C’est devenu peu à peu la norme au cours des 19e et 20e siècles. L’argent versé était au départ pour des bonnes œuvres !
Aujourd’hui on essaie de revenir sur cette « norme », l’emprise des villes est un casse-tête pour les urbanistes et la tendance est de consacrer moins d’espace aux vestiges funéraires, donc les surfaces disponibles diminuent… Les SDF et autres personnes sans ressources ont droit au minimum, c’est à dire d’être inhumés en pleine terre (toujours avec un cercueil). Au bout de cinq ans, hop, on peut éventuellement réutiliser l’espace pour d’autres, les restes étant rassemblés sur un lieu commun (par contre l’inhumation directe en fosse commune n’existe plus légalement).
L’humusation
C’est le dépôt direct du corps dans ou sur le sol, elle est illégale en France. Des études sont en cours et des collectifs et associations militent pour le dépôt du corps sur un humus actif, recouvert de terre. Il faut entre 4 mois et 1 an pour que le corps se décompose, et il reste les os. Et ce nouvel humus, on en fait quoi ? Le m³ de terre, les os ? Tactique : une forme de dispersion pourrait être envisagée, un compost partagé déposé aux pieds des arbres, dans les pelouses, parcs du souvenir…
Une méthode proche, la « terramation », légale dans certains États d’Amérique, permet de faire la même chose, mais les américains ont choisi des techniques hors-sol, industrielles, dans des containers, coûteux en termes d’énergie électrique et matériaux…
Pour aller plus loin :
On termine ce petit tour non exhaustif, par quelques liens, pistes et sites web. C’est un peu macabre mais avouons que le rendez-vous est non évitable pour chacun et chacune de nous.
– des coopératives funéraires, comme exemples d’entreprises pouvant être prestataires de services : à Rennes, lacoopfunerairederennes.fr ; à Bordeaux, sypres.coop ; et à Brive et Tulle on trouve les agences de la coopérative le-choix-funeraire.com
– un livre : Un enterrement comme je veux, de Sarah Dumont, Eyrolles, 2021. (Onze premières pages consultables sur le web).
– deux sites sur l’humusation et la terramation : humusationfrance.org et humosapiens.fr
- nombreuses précisions sur le site de l’association française d’information funéraire – association loi 1901 à but non lucratif : afif.asso.fr
- En 2022, un cercueil avait explosé et endommagé un four… à cause d’une bombe de laque oubliée ! Un autre fait divers dangereux : des pétards placés dans un cercueil…
Par CHRISTOPHE RASTOLL
 La Trousse Corrézienne DU LOCAL, DU LIBRE, DU BEAU, DE L'ECOLOGIE, DU DRÔLE, DU FRAIS
La Trousse Corrézienne DU LOCAL, DU LIBRE, DU BEAU, DE L'ECOLOGIE, DU DRÔLE, DU FRAIS